Découvrez l’Association
de la Noblesse du
Royaume de Belgique
ANRB - VAKB
À la une
L'année de la confusion
Au moins cinq événements ont provoqué cette année une confusion politique, économique et sociale : le second mandat du président Trump, l'effritement de la mondialisation, l'impuissance de l'Europe, l'avancée rapide de l'intelligence artificielle et la montée en puissance géopolitique de la Chine. Ces cinq-là sont mon choix. Il y en a d'autres et bien sûr il y a la crise climatique, mais elle crée de la confusion depuis longtemps. Le dictionnaire définit la confusion comme : « s'emmêler, ne pas trouver une issue ». C'est fortement formulé, mais c'est ce que je veux dire. Le monde calme et stable que nous avons connu durant les deux décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale, a disparu depuis longtemps. Bien que la stabilité fût déjà un concept très relatif à l'époque.Trump souverain.Donald Trump est un type de président différent. Trump est soi-disant républicain, mais en réalité, il ne l'est pas. Il ne défend pas l'économie de marché libre parce qu'il veut décider lui-même des taux d'intérêt et tient à orienter le commerce international. Il réduit les impôts pour les plus aisés mais ne semble pas se soucier du déficit budgétaire. Il n'est pas démocrate non plus, bien qu'il suive une politique qui conviendrait parfaitement aux démocrates : rouvrir les usines dans la Rust Belt et créer des emplois pour les classes moyennes. Les démocrates ont grossièrement négligé cet aspect. Ils l’ont payé très cher électoralement. Contrairement à ses prédécesseurs récents, Trump n'est ni républicain ni démocrate, il ressemble à un souverain européen du 19e siècle. Un souverain décide de manière autonome des droits d'importation et utilise ces droits pour punir ou récompenser des pays. Les considérations économiques jouent à peine un rôle dans cette affaire. Une taxe est imposée à un pays parce que le souverain en a décidé ainsi. Les célèbres checks and balances qui ont caractérisé le système politique américain sont contournés. Mais ils ne sont certainement pas encore complètement éliminés. Les prochaines décisions de la Cour Suprême fédérale seront cruciales à cet égard. La mesure dans laquelle la Réserve Fédérale reste indépendante sera également un baromètre pour le genre de présidence que souhaite Donald Trump. Un mot enfin sur les alliances internationales et le multilatéralisme. Nous avons grandi dans un monde où les blocs étaient clairs : unipolaire, bipolaire ou multipolaire. Cela changeait parfois, mais en général il était clair qui appartenait à quel bloc. Aujourd'hui, les amis sont presque devenus des ennemis et les ennemis sont traités comme des amis. Il est difficile pour les organisations internationales et pour les coopérations multilatérales de rester pertinentes.L'effritement de la mondialisation.La conséquence immédiate est que la mondialisation de l'économie mondiale s'effrite. C’est déjà arrivé. La mondialisation fluctue sur le long terme. Elle a atteint son apogée au début du 20e siècle et s'est effondrée pendant la première guerre mondiale. Tout a recommencé dans les années soixante. L'effritement de la mondialisation a des conséquences négatives pour la croissance de l'économie mondiale. Mais aussi pour l'inégalité économique entre les pays. Cette inégalité augmentera de nouveau. C'est souvent un sujet de discussion social. Néanmoins, de nombreuses études montrent que la mondialisation a rendu le monde moins inégal, principalement grâce à la croissance spectaculaire de la Chine et des économies asiatiques. Ce qui adviendra de l'inégalité ne sera pas une préoccupation majeure pour Trump. Mais cet effritement menace la position mondiale du dollar et le financement de la dette publique américaine. Les pays BRICS ne représentent pas encore une menace concrète pour l’instant, mais ces nations, et certainement la Chine, rêvent d'une monnaie mondiale concurrente et d'un propre système de paiement.L'impuissance de l'Union EuropéenneL'impuissance de l'Europe est devenue évidente en 2025. Les dirigeants européens étaient à peine impliqués dans les consultations sur l'Ukraine et l'Europe n'a même pas eu droit au chapitre concernant Gaza. Même lors de la conférence climatique, l'Europe a eu du mal. Il y a de nombreuses raisons à cela. L'essentiel est que l'Europe a perdu son pouvoir géopolitique parce qu'elle a perdu son véritable pouvoir économique. La croissance économique en Europe est bien trop faible depuis des années. L'Europe a également négligé et ignoré son industrie. La conséquence de cette négligence, c’est que l'Europe doit râcler les fonds de tiroir pour trouver des moyens de remplir un rôle crédible. L'Europe doit jouer un rôle en Ukraine, mais elle ne peut pas trouver ni libérer les moyens d'imposer sa volonté. Si l'Europe veut trouver une place entre les États-Unis et la Chine, elle devra changer : plus combattive dans la prise de décision et moins préoccupée par des formalités de technocrates. L'Europe doit à nouveau inspirer. N'écrivez pas à quel point l'Europe est bonne, mais faites-le.L'avancée rapide de l'intelligence artificielleL'Europe tente de rattraper son retard dans le domaine de l'IA. Ne désespérez pas, l'Europe a certainement des atouts maîtres. Mais en Europe, on accorde plus d'attention aux dangers de l'IA qu'à ses opportunités. Il y a un an, Mario Draghi a incité l'Europe à changer de cap et à se concentrer sur la compétitivité. Draghi a récemment noté que peu de choses de son plan avaient été mises en œuvre. Cela dit, il ne faut pas se laisser subjuguer par le battage médiatique de l'IA. The Economist a récemment montré que les cours des actions américaines d'IA sont probablement exagérés et qu’ils pourraient entraîner une crise financière. Pensez à la fameuse crise Dotcom. Une crise financière peut entraîner une récession économique. Ce n'est pas bon pour les entreprises européennes qui souffrent déjà de la lente croissance et de la faible compétitivité européenne. Comme l'a dit Draghi, l'Europe doit se concentrer sur l'innovation technologique. Ceci est souvent interprété comme étant une transformation digitale. C'est une interprétation trop étroite. Il existe plusieurs domaines où l'Europe est forte et où les autres grands concurrents, comme les États-Unis ou la Chine, sont moins dominants. Je pense à quelques spécialisations en chimie. L'Europe peut également jouer un rôle important dans la technologie du traitement médical.Le rôle de la ChineIl fut un temps où la Chine était traitée avec un regard compatissant : une économie qui copie nos innovations. Il y a quarante ans, on disait la même chose du Japon. Les États-Unis et l'Europe étaient les pays innovants. Le Japon puis la Chine ont copié. Depuis lors, les temps ont changé. Nous ne devons pas commettre la même erreur aujourd'hui. Économiquement, l'Europe souffre beaucoup de la Chine. La Chine a développé une grande capacité de production très moderne. L'infrastructure chinoise est souvent excellente. Maintenant que le marché américain est moins accessible à cause des droits d'importation, les entreprises chinoises envahissent le marché européen. Par exemple, notre industrie chimique et notre industrie automobile ont subi de fortes pressions. C'est une compétition de prix mais aussi une compétition de produits. Leurs produits conviennent mieux à certains segments de marché que les nôtres. Les petites voitures électriques le prouvent. L'Europe ne doit pas commettre d'erreur stratégique et exclure la Chine. La Chine devient une puissance technologique, elle compte plus d'ingénieurs que n'importe quel autre pays, peut-être à l'exception de l'Inde. Une grande partie de la recherche scientifique aux États-Unis a été et est réalisée par des doctorants asiatiques. Cela signifie qu'une partie du pouvoir innovant des États-Unis provient des immigrés asiatiques et des Chinois. L'Europe ne peut pas gagner cette bataille technologique sans des partenariats avec la Chine.C'est clair ! L'économie mondiale a subi plusieurs chocs. J'en ai mentionné cinq, mais il y en a d'autres. Les chocs nous embrouillent. Nous ne savons pas vraiment comment gérer tout ça. On se retrouve piégés. C'est pourquoi nous devons tout faire pour encourager le leadership à tous les niveaux. Baron (Herman) Daems,23 novembre 2025
Actualités
"Trait d'union entre particules"
Paru en octobre 2025 : "La Famille dans la Belgique d’aujourd’hui"Moins d’un siècle après la publication de La Famille dans la Belgique d’autrefois par le comte Louis de Lichtervelde, le concept de famille connaît une transformation sans précédent. Dans une société marquée par un individualisme croissant, la cellule familiale traditionnelle se redéfinit sans cesse, partagée entre mémoire collective et aspirations personnelles.Cet essai interroge la place de la famille aujourd’hui : l’éducation, la transmission, l’habitat, les structures émergentes, le rôle des grands-parents, les politiques publiques… autant de dimensions qui éclairent les tensions et recompositions actuelles. Au cœur de cette réflexion, une question essentielle : que signifie encore « la Famille » dans sa complexité contemporaine ?Volume de 153 pages, format A5, couverture souple, diffusion restreinte.Prix : 20 € (+ frais d’envoi éventuels pour la Belgique).ISBN : 978-2-9603805-0-7Possibilité de récupérer, sur rendez-vous, votre exemplaire au Bureau d’Iconographie de l’ANRB.Contact : Pierre-Alexandre de Lannoy - pieralexdelannoy@gmail.comDate de parution: 24 novembre 2025 : "Alles Welbeschouwd. Een bevoorrecht leven"Journaliste envoyée aux quatre vents, Mia Doornaert y a appris une vérité cardinale : les étrangers sont différents, et nous le sommes pour eux, car pétris par une histoire et une culture radicalement différentes. Ã base de ses souvenirs, elle fait vivre les grands acteurs géopolitiques – Amérique, Russie, Moyen-Orient, une Europe perméable à l’islam – à partir de leur propre histoire.Mia Doornaert "Alles Welbeschouwd. Een bevoorrecht leven". 320 p. Date de parution: 24 novembre 2025. Ertsberg/Standaard Uitgeverij."Petite Philosophie des categories inévitables" par Luc de Brabandere - Ed. EyrollesDans son dernier ouvrage, Luc de Brabandere nous émerveille encore par son érudition, sa clairvoyance et son humour.Il démontre avec un brio et une clarté remarquable que penser, communiquer et agir ne peut se faire qu'en structurant le monde qui nous entoure, en le répartissant dans des cases, donc en créant inévitablement des catégories. Prenez une conversation au hasard et vous remarquerez que les catégories sont partout ! Qu'il s'agisse d'espèces en voie de disparition, de secteur de l'économie, de familles politiques, de genre littéraire ou encore de discipline scientifique, la démarche est toujours la même : un domaine complexe est découpé en morceaux dans le but d'être appréhendé.Et cela depuis la nuit des temps !Mais, au fil du temps et des époques, des catégories changent, certaines disparaissent, d'autres apparaissent, pour mieux refléter et structurer l'évolution du monde, de la société et des mentalités. Dans cette perspective, les catégories ne sont pas seulement inévitables, mais aussi indispensables.L'auteur parsème son histoire des catégories avec des exemples savoureux. Plus inquiétant, il nous alerte à juste titre sur l'émergence des algorithmes qui permettent aux géants du numérique (Amazon, FB, Google, ...) de créer des catégories à la demande et sur mesure. Enfin, il nous montre que les trois modes de pensée - pensée logique, pensée créative et pensée critique - impliquent chacun, malgré leurs grandes différences, la manipulation de catégories.Cette huitième Petite Philosophie sur l'idée de catégorie est un bonheur de lecture que nous vous recommandons vivement.Dans "La Huppe et la reine de Saba", Catherine d’Oultremont réinvente la légende de Makéda : royaume matriarcal, magie solaire, intrigues et voyage initiatique où s’entrelacent passions, identité, mystères et pouvoir. La Huppe et la reine de Saba | Asmodée Edern ÉditionsDate de parution : 25/10/2025Editeur EdernNombre de pages 232
L'année de la confusion
Au moins cinq événements ont provoqué cette année une confusion politique, économique et sociale : le second mandat du président Trump, l'effritement de la mondialisation, l'impuissance de l'Europe, l'avancée rapide de l'intelligence artificielle et la montée en puissance géopolitique de la Chine. Ces cinq-là sont mon choix. Il y en a d'autres et bien sûr il y a la crise climatique, mais elle crée de la confusion depuis longtemps. Le dictionnaire définit la confusion comme : « s'emmêler, ne pas trouver une issue ». C'est fortement formulé, mais c'est ce que je veux dire. Le monde calme et stable que nous avons connu durant les deux décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale, a disparu depuis longtemps. Bien que la stabilité fût déjà un concept très relatif à l'époque.Trump souverain.Donald Trump est un type de président différent. Trump est soi-disant républicain, mais en réalité, il ne l'est pas. Il ne défend pas l'économie de marché libre parce qu'il veut décider lui-même des taux d'intérêt et tient à orienter le commerce international. Il réduit les impôts pour les plus aisés mais ne semble pas se soucier du déficit budgétaire. Il n'est pas démocrate non plus, bien qu'il suive une politique qui conviendrait parfaitement aux démocrates : rouvrir les usines dans la Rust Belt et créer des emplois pour les classes moyennes. Les démocrates ont grossièrement négligé cet aspect. Ils l’ont payé très cher électoralement. Contrairement à ses prédécesseurs récents, Trump n'est ni républicain ni démocrate, il ressemble à un souverain européen du 19e siècle. Un souverain décide de manière autonome des droits d'importation et utilise ces droits pour punir ou récompenser des pays. Les considérations économiques jouent à peine un rôle dans cette affaire. Une taxe est imposée à un pays parce que le souverain en a décidé ainsi. Les célèbres checks and balances qui ont caractérisé le système politique américain sont contournés. Mais ils ne sont certainement pas encore complètement éliminés. Les prochaines décisions de la Cour Suprême fédérale seront cruciales à cet égard. La mesure dans laquelle la Réserve Fédérale reste indépendante sera également un baromètre pour le genre de présidence que souhaite Donald Trump. Un mot enfin sur les alliances internationales et le multilatéralisme. Nous avons grandi dans un monde où les blocs étaient clairs : unipolaire, bipolaire ou multipolaire. Cela changeait parfois, mais en général il était clair qui appartenait à quel bloc. Aujourd'hui, les amis sont presque devenus des ennemis et les ennemis sont traités comme des amis. Il est difficile pour les organisations internationales et pour les coopérations multilatérales de rester pertinentes.L'effritement de la mondialisation.La conséquence immédiate est que la mondialisation de l'économie mondiale s'effrite. C’est déjà arrivé. La mondialisation fluctue sur le long terme. Elle a atteint son apogée au début du 20e siècle et s'est effondrée pendant la première guerre mondiale. Tout a recommencé dans les années soixante. L'effritement de la mondialisation a des conséquences négatives pour la croissance de l'économie mondiale. Mais aussi pour l'inégalité économique entre les pays. Cette inégalité augmentera de nouveau. C'est souvent un sujet de discussion social. Néanmoins, de nombreuses études montrent que la mondialisation a rendu le monde moins inégal, principalement grâce à la croissance spectaculaire de la Chine et des économies asiatiques. Ce qui adviendra de l'inégalité ne sera pas une préoccupation majeure pour Trump. Mais cet effritement menace la position mondiale du dollar et le financement de la dette publique américaine. Les pays BRICS ne représentent pas encore une menace concrète pour l’instant, mais ces nations, et certainement la Chine, rêvent d'une monnaie mondiale concurrente et d'un propre système de paiement.L'impuissance de l'Union EuropéenneL'impuissance de l'Europe est devenue évidente en 2025. Les dirigeants européens étaient à peine impliqués dans les consultations sur l'Ukraine et l'Europe n'a même pas eu droit au chapitre concernant Gaza. Même lors de la conférence climatique, l'Europe a eu du mal. Il y a de nombreuses raisons à cela. L'essentiel est que l'Europe a perdu son pouvoir géopolitique parce qu'elle a perdu son véritable pouvoir économique. La croissance économique en Europe est bien trop faible depuis des années. L'Europe a également négligé et ignoré son industrie. La conséquence de cette négligence, c’est que l'Europe doit râcler les fonds de tiroir pour trouver des moyens de remplir un rôle crédible. L'Europe doit jouer un rôle en Ukraine, mais elle ne peut pas trouver ni libérer les moyens d'imposer sa volonté. Si l'Europe veut trouver une place entre les États-Unis et la Chine, elle devra changer : plus combattive dans la prise de décision et moins préoccupée par des formalités de technocrates. L'Europe doit à nouveau inspirer. N'écrivez pas à quel point l'Europe est bonne, mais faites-le.L'avancée rapide de l'intelligence artificielleL'Europe tente de rattraper son retard dans le domaine de l'IA. Ne désespérez pas, l'Europe a certainement des atouts maîtres. Mais en Europe, on accorde plus d'attention aux dangers de l'IA qu'à ses opportunités. Il y a un an, Mario Draghi a incité l'Europe à changer de cap et à se concentrer sur la compétitivité. Draghi a récemment noté que peu de choses de son plan avaient été mises en œuvre. Cela dit, il ne faut pas se laisser subjuguer par le battage médiatique de l'IA. The Economist a récemment montré que les cours des actions américaines d'IA sont probablement exagérés et qu’ils pourraient entraîner une crise financière. Pensez à la fameuse crise Dotcom. Une crise financière peut entraîner une récession économique. Ce n'est pas bon pour les entreprises européennes qui souffrent déjà de la lente croissance et de la faible compétitivité européenne. Comme l'a dit Draghi, l'Europe doit se concentrer sur l'innovation technologique. Ceci est souvent interprété comme étant une transformation digitale. C'est une interprétation trop étroite. Il existe plusieurs domaines où l'Europe est forte et où les autres grands concurrents, comme les États-Unis ou la Chine, sont moins dominants. Je pense à quelques spécialisations en chimie. L'Europe peut également jouer un rôle important dans la technologie du traitement médical.Le rôle de la ChineIl fut un temps où la Chine était traitée avec un regard compatissant : une économie qui copie nos innovations. Il y a quarante ans, on disait la même chose du Japon. Les États-Unis et l'Europe étaient les pays innovants. Le Japon puis la Chine ont copié. Depuis lors, les temps ont changé. Nous ne devons pas commettre la même erreur aujourd'hui. Économiquement, l'Europe souffre beaucoup de la Chine. La Chine a développé une grande capacité de production très moderne. L'infrastructure chinoise est souvent excellente. Maintenant que le marché américain est moins accessible à cause des droits d'importation, les entreprises chinoises envahissent le marché européen. Par exemple, notre industrie chimique et notre industrie automobile ont subi de fortes pressions. C'est une compétition de prix mais aussi une compétition de produits. Leurs produits conviennent mieux à certains segments de marché que les nôtres. Les petites voitures électriques le prouvent. L'Europe ne doit pas commettre d'erreur stratégique et exclure la Chine. La Chine devient une puissance technologique, elle compte plus d'ingénieurs que n'importe quel autre pays, peut-être à l'exception de l'Inde. Une grande partie de la recherche scientifique aux États-Unis a été et est réalisée par des doctorants asiatiques. Cela signifie qu'une partie du pouvoir innovant des États-Unis provient des immigrés asiatiques et des Chinois. L'Europe ne peut pas gagner cette bataille technologique sans des partenariats avec la Chine.C'est clair ! L'économie mondiale a subi plusieurs chocs. J'en ai mentionné cinq, mais il y en a d'autres. Les chocs nous embrouillent. Nous ne savons pas vraiment comment gérer tout ça. On se retrouve piégés. C'est pourquoi nous devons tout faire pour encourager le leadership à tous les niveaux. Baron (Herman) Daems,23 novembre 2025
Rencontre avec Bénédicte van Zeeland, infirmière en milieu carcéral : soigner derrière les barreaux
À l'âge de 50 ans, j'ai choisi d'opérer une réorientation professionnelle mûrement réfléchie après avoir travaillé la majeure partie de ma carrière au sein d'un service d'urgences. J'ai souhaité mettre mes compétences au service d'une population différente, dans un environnement unique et spécifique. C'est ainsi que j'ai intégré l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut en tant qu'expert technique médical pénitentiaire.Philippe de Potesta : Comment vivez-vous le rythme d’une journée en prison ?Bénédicte van Zeeland : Le rythme de la prison est certes contraint par la sécurité, mais je l'aborde comme une opportunité d'exercer mon métier de soignante. Le quotidien peut être émotionnellement éprouvant et demande une vigilance constante. La satisfaction ressentie lorsque l'on parvient à établir une connexion, à soulager une douleur ou à soutenir un détenu dans sa prise en charge donne tout son sens à notre travail. L'objectif est de faire exister l'humanité du soin, même face aux comportements les plus ardus.Mes consultations sont des moments privilégiés qui me permettent d'établir un lien avec les détenus. Mais je ne me voile pas la face: certains détenus ne sont pas toujours "gentils" ou coopératifs: insultes et comportements agressifs font malheureusement partie du tableau. Ces réactions reflètent souvent une grande souffrance, une frustration face au système, un manque total de repères ou encore un manque d'éducation. Ma priorité reste le soin. Je maintiens mes limites claires, je rappelle le cadre, les règles de respect mutuel, tout en garantissant la confidentialité absolue.Philippe de Potesta : Comment établissez-vous la relation de soin et comment se déroule leur suivi médical ?Bénédicte van Zeeland : La relation de soin et le suivi médical des détenus sont guidés par le principe d'équivalence de soins (droit à avoir des soins équivalents à ceux prodigués à la société civile) et par le respect des droits du patient dont le secret professionnel.Elle repose sur plusieurs piliers essentiels :- Nous abordons les détenus sans jugement et avec empathie comme des individus à part entière, indépendamment des raisons de leur incarcération en veillant à la continuité des soins avant, pendant et après leur détention.- Nous garantissons la confidentialité des informations médicales, condition essentielle pour instaurer la confiance.- A leur arrivée, une évaluation initiale (incluant l'état médical, psychologique et le risque suicidaire, particulièrement élevé en début de détention) est réalisée. Un examen médical est effectué par un médecin et une infirmière dans les 24 heures de son arrivée. Il permet d'évaluer l’état de santé du détenu, d'identifier ses problèmes physiques et psychiques et d'assurer la poursuite des traitements en cours: ex: traitements de substitution pour les toxicomanes.Chaque établissement dispose d'une équipe de soins pluridisciplinaire: avec des médecins généralistes, infirmiers, psychiatre, psychologues, dentiste, kinésithérapeute. Les détenus ont le droit de demander à voir l'infirmerie tous les jours: nous y assurons les premiers soins: (plaies, fractures, prises de sang, électrocardiogrammes, douleurs dentaires, etc.) tandis que les consultations spécialisées sont organisées suivant un calendrier de rendez-vous.- Bien que je travaille dans un milieu sécurisé en étroite collaboration avec les surveillants, je tiens à maintenir mon identité professionnelle d'infirmière. Cette neutralité est perçue comme telle par les détenus et facilite le lien de confiance.Philippe de Potesta : La détention peut-elle être un levier de transformation personnelle ?Bénédicte van Zeeland : La transformation dépend avant tout de la volonté et de la résilience du détenu. Le système propose des outils: travail, formation professionnelle, activités culturelles et sportives et programmes thérapeutiques mais le cheminement est personnel. Les parcours de réinsertion les plus probants concernent généralement les détenus qui ont admis leur culpabilité et manifestent la volonté de réparer le préjudice aux victimes.Mais je constate aussi que la surpopulation carcérale, la violence et l'influence d'autres détenus peuvent saboter ces efforts et aggraver les situations. Les moyens humains et matériels alloués à la réinsertion restent insuffisants, ce qui limite nos actions.Philippe de Potesta : En quoi le travail d’infirmière en milieu carcéral diffère-t-il de celui en milieu hospitalier ?Bénédicte van Zeeland : Il se distingue surtout par le cadre sécuritaire contraignant, la globalité des soins et la spécificité de la population.Nous travaillons avec des règles strictes et dépendons des agents pour l'organisation concrète de notre travail: la sécurité prime et peut impacter l'organisation de nos soins.Nous traitons un large éventail de pathologies: problèmes de santé mentale, assuétudes, maladies infectieuses, soins chroniques et urgences avec des ressources plus limitées qu'à l'hôpital, ce qui exige une grande polyvalence. Nous assurons à la fois le suivi, le dépistage et la prévention.Un autre point à souligner aussi est leur demande de soins qui peut être manipulatrice: je dois souvent démêler ce qui relève d'une vraie demande de ce qui serait plutôt une tentative pour sortie de cellule ou un désir d'accéder à des médicaments détournés. Cela peut parfois être épuisant mais cela fait partie du notre travail.Philippe de Potesta : Un tout grand merci à Bénédicte van Zeeland pour cet échange et la qualité de ses réponses.Nous remercions également Philippe de Potesta
Enjoy Saint-Nicolas Light…
Au cœur de la nuit précédant le 6 décembre, une silhouette barbue, reconnaissable entre mille, se déplace de toit en toit. De vous à moi, il s’agit du grand saint Nicolas, accompagné de son âne. En Flandre, la tradition lui octroya un cheval blanc à l’instar de son confrère Saint Émilion…Figure majeure du christianisme, saint Nicolas trouve son origine en Nicolas de Myre, né au IIIᵉ siècle à Patara, en Asie Mineure. Devenu évêque, il se distingua par sa bonté et sa protection des enfants, des pauvres et des marins. Persécuté sous Dioclétien, il retrouva son ministère après l’édit de Constantin en 313. Mort le 6 décembre 343, ses reliques furent transférées à Bari en 1087, ce qui contribua à renforcer son culte. Célébré pour ses miracles et sa générosité, il devint le saint patron de nombreux métiers mais surtout le protecteur des enfants.Selon la légende, trois jeunes garçons, cherchant refuge chez un boucher, furent tués par ce dernier, homme d’une grande cruauté, qui les enferma dans un tonneau. Plus tard, saint Nicolas vint les ressusciter à dos d’âne. Soit, ce récit des « trois petits enfants partis glaner aux champs » s’est profondément enraciné dans la mémoire collective.La veille de sa fête, accompagné du Père Fouettard, le Grand Saint apporte friandises, pains d’épices et autres spéculoos aux enfants sages. Arrêtons-nous un instant au mot friandise. S’il évoque la douceur de l’enfance, la généreuse main tendue d’une grand-mère bienveillante ou l’odeur caractéristique d’un feu d’artifice buccal, il mériterait presque un mode d’emploi, afin que les enfants obéissants ne soient pas punis par la vilaine carie qui rôde par là.Le sucre… ces petits granulés, qui adoucissent les aliments mais moins les mœurs, agit sur nos émotions. Halloween n’est d’ailleurs pas bien loin quand on parle de saccharose : ce mot édulcoré cache un parfum de mystère, et rime étrangement avec nécrose, psychose ou cirrhose. De quoi rappeler que derrière le caractère mielleux du sucre se dissimule souvent un petit goût de frayeur !En effet, le dernier rapport, daté de novembre 2025, de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a de quoi faire froid dans le dos : « Dans les pays participants, 1 enfant sur 4 (25 %) âgé de 7 à 9 ans est en surpoids (y compris obèse) et 1 sur 10 (11 %) est obèse. Les garçons (13 %) sont plus susceptibles de souffrir d’obésité que les filles (9 %), avec une forte variation de la prévalence ». Le rapport ajoute que cette prévalence du surpoids et de l’obésité « favorise l’apparition du diabète, du cancer, des maladies cardiovasculaires et d’autres maladies non transmissibles potentiellement mortelles. Parallèlement, les parents d’enfants souffrant de surpoids ou d’obésité ont tendance à sous-estimer l’état pondéral de leurs enfants ».Mais alors, faut-il se cacher de ce saint qu’il nous faudrait voir ? Non pardi ! Les traditions font partie de notre royaume, et le 6 décembre aussi ! Et puisqu’il n’est pas question de renoncer à la fête, pourquoi ne pas la célébrer allégée ?Si vous ne savez pas à quel saint vous vouer, voici de quoi remplacer la gélatine de porc tout en gardant le côté fruité qui fait tant plaisir à nos gastronomes en construction : clémentines, mandarines, pommes, fruits secs ou, pour les plus courageux, des energy balls ou des barres de sain granola (composées d’un mélange de céréales, de graines, de fruits secs et de noix), ainsi que des cookies, biscuits ou gâteaux composés simplement de fruits ou de légumes, d’oléagineux et, si nécessaire, de quelques œufs…Il ne faut pas glisser des cakes aux courgettes dans les pantoufles de vos marmots pour autant, mais simplement leur rappeler que le mulet, tout comme le blanc canasson, se contente bien d’une maigre carotte…Nous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
Ensemble, mettre fin au sans-abrisme.
Emilie Meessen, c’est l’énergie du cœur au service de ceux qu’on oublie trop souvent. Infirmière, co-fondatrice avec Sara Janssens de Bisthoven de l’ASBL Infirmiers de rue, nous avons pu la rencontrer.Votre démarche est profondément humaine et utile. Comment est née votre idée ?Infirmière de formation, j’ai toujours travaillé dans le social et en psychiatrie. J’ai ainsi eu l’opportunité de travailler et de créer des postes infirmiers dans différentes organisations pour les personnes sans-abri ou souffrant de problèmes de toxicomanie.En 2005, avec Sara, nous avons réalisé une étude de terrain à Bruxelles pour voir s’il y avait besoin de créer un nouveau lien vers les personnes sans-abri et leur permettre de reprendre confiance en elles et regagner l’envie de se soigner. C’est ainsi qu’après avoir rencontré une trentaine d’associations et services médicaux, Infirmiers de rue (IDR) a pu naître.L’idée a évolué au fur et à mesure des 20 ans. La méthodologie s’est affinée et professionnalisée. Notre vision s’est également élargie progressivement à la suite des réussites de terrain et de l’expérience avec les personnes sans abri.Chaque collègue et bénévole a ajouté sa pierre à l’édifice et a permis à l’association de grandir.Vous dites que les sans-abri doivent retrouver l’estime de soi, condition pour sortir de la rue. Comment vous y prenez-vous ?L’association a développé une méthodologie basée sur l’hygiène et la santé afin d’aider les plus vulnérables à reprendre confiance en eux et à trouver un logement stable et durable, moteur de bien-être.Nous avons trois équipes de terrain : Rue – Logement- MyWay.La 1e travaille sur l’hygiène et la revalorisation de la personne pour l’estime de soi, pour la motiver à reprendre soin d’elle et l’aider à susciter le changement.La 2e accompagne les personnes en logement avec la méthodologie « Housing First » pour leur réapprendre à se recréer de nouvelles habitudes et prendre soin d’elles.La 3e, l’équipe MyWay, aide la personne à se reprojeter dans le futur. Elle est déjà stabilisée dans son logement, il est possible alors de créer de nouvelles envies.Vous êtes aussi infirmière spécialisée en Santé communautaire. Pouvez-vous nous en dire plus ?Le soin est plus qu’un acte, c’est un accompagnement. Pour nous, l’hygiène est devenu un outil diagnostique et thérapeutique : c’est un langage du corps quand les mots ne viennent plus. La solution ne vient jamais d’un seul acteur mais de la coopération entre citoyens, soignants, institutions et services publics. Je suis convaincue qu’une action collective est indispensable à des résultats durables.Cela fait 20 ans maintenant que vous avez créé cette association majeure. Comment vous et votre équipe évoluez-vous à l’heure actuelle ?Chaque jour, sur le terrain, je vois des raisons d’espérer, des équipes qui se mobilisent, des citoyens qui tendent la main, des collaborations improbables qui sauvent des vies. Ces « bonnes nouvelles », partagées régulièrement au sein de l’association, deviennent des sources d’énergie et de persévérance.Cependant l’asbl Infirmiers de rue est régulièrement confrontée à des obstacles structurels, par exemple : la fragmentation des institutions (santé mentale/addiction/maladie chronique) qui complique la coordination et d’autre part la précarité des financements : le budget repose pour la moitié sur des subsides publics et pour moitié sur des dons privés. Or les premiers sont soumis aux choix politiques et au coupes budgétaires, tandis que les seconds dépendent de la communication autour de notre projet et de l’envie de chaque donateur de nous soutenir – cela crée un climat d’incertitude permanent. Et j’en profite donc pour remercier sincèrement l’ARNB de nous faire connaitre , ainsi que notre site internet (www.infirmiersderue.org) au travers cet article.Notre travail n’a de sens que si tout le monde s’y met et participe à sa façon!Le véritable enjeu, c’est d’accepter que la valeur d’une personne ne se mesure pas à sa productivité. Une société solidaire ne se demande pas si un individu est « rentable » mais comment il peut, à sa manière, contribuer et participer au vivre-ensemble.Redoutez-vous l’arrivée de l’hiver, au vu du manque criant de places d’hébergement ?Oui, car la vie à la rue abîme tout : les corps, les esprits, la dignité. Beaucoup de personnes finissent par perdre la sensibilité au froid, à la douleur ou même aux odeurs…ce qui est un mécanisme de survie.Guérir en rue est impossible. Le logement fait partie du traitement. Nous parlons d’un logement adapté et accessible, dont la personne paye le loyer.La fin du sans-abrisme est-elle possible ?Bien sûr – nous avons la chance d’habiter en Belgique où il y a énormément de moyens et de possibilités, il ne manque « plus que » la motivation politique !« Le courage est d’essayer » même si c’est plus compliqué que prévu !Puissent ces quelques paroles prononcées avec détermination, conviction et optimisme être entendues !Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour la réalisation de cette interview.
Événements
Conférence parentalité : PASCAL CHABOT “ Un sens à la vie
Pascal Chabot, Philosophe, conférencier et enseignant à l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS – Bruxelles), Pascal Chabot a été chercheur au FNRS et conseiller artistique de la chorégraphe Michèle Noiret. Il est l'auteur d’une douzaine de livres parus aux Presses Universitaire de France Le sens est partout, mais sa définition nulle part. On veut du sens pour son travail, dans ses relations, face au système. Mais au juste, que cherche-t-on en cherchant du sens ? Que cache ce Graal, le sens de la vie, devenu tellement important qu’il semble avoir supplanté le bonheur ? La question est d’autant plus difficile qu’une mutation majeure nous a transformé. Car dès que nous faisons le geste de consulter un écran, nous nous branchons au « surconscient » numérique qui bouleverse notre rapport au sens. De là, ce qu’il faut appeler les « digitoses » contemporaines : le burn-out, l’éco-anxiété, la rivalité avec l’intelligence artificielle et le triomphe des machinoïdes, ces humains qui se ressemblent à leurs outils. Dans ce monde vertigineux, comment faire mûrir en soi la quête de sens, pour qu’elle triomphe ou s’accommode des puissances qui la formatent ?Conférence donnée par Pascal Chabot.Inscriptions : www.bit.ly/Conférenceparentalitémail : conferencesdesparents@anrb-vakb.be Ouverture des portes : 19:45 - Conférence : 20:00
Conférences Parentalité : DAVID VAN YPERSELE “ Retrouver l'autorité sans perdre le lien: La force tranquille de la Résistance Non Violente”
David van Ypersele est psychologue, thérapeute familial systémicien et superviseur d’équipes en santé mentale. Après avoir travaillé treize ans en pédopsychiatrie aux Cliniques Saint-Luc, où il a co-dirigé le centre de référence autisme, il exerce depuis vingt-sept ans dans un hôpital pédopsychiatrique. Il y accompagne des enfants présentant de graves troubles du comportement. Parallèlement, il reçoit des familles en pratique indépendante. Depuis quelques années, il s’est particulièrement investi dans le modèle de la nouvelle autorité et de la résistance non violente, qu’il utilise auprès des familles. La Résistance Non Violente (Non Violent Resistance) est une approche thérapeutique développée par le Prof. Haim Omer et son équipe de l’Université de Tel Aviv. Destinée aux parents et aux professionnels confrontés à des problèmes de comportements sévères chez l’enfant et l’adolescents, cette approche a démontré son efficacité à travers de multiples études. Depuis de nombreuses années, la RNV est utilisée dans des contextes tels que la thérapie familiale, l’aide à la jeunesse, l’enseignement, développant ainsi une nouvelle façon de faire autorité. Elle propose des solutions originales non seulement pour les troubles externalisés du comportement tels que l’opposition et les conduites anti- sociales, mais également pour les troubles internalisés comme le trouble anxieux. Les principes de la Résistance Non-Violente se diffusent de plus en plus partout dans le monde et sont déjà implémentés dans de nombreux pays d’Europe.Conférence donnée par David van Ypersele.
Déjeuners Gourmands : C'est du belge !
C'est du belge ! ➤ Bridge & initiation au scrabble en duplicate avec Sophie de Troostembergh. Partagez un moment chaleureux avec Cécile Poswick et son équipe dans les salons de l’ANRB (12h). Prolongez l’après-midi autour d’une table de bridge ou de scrabble si vous le souhaitez.
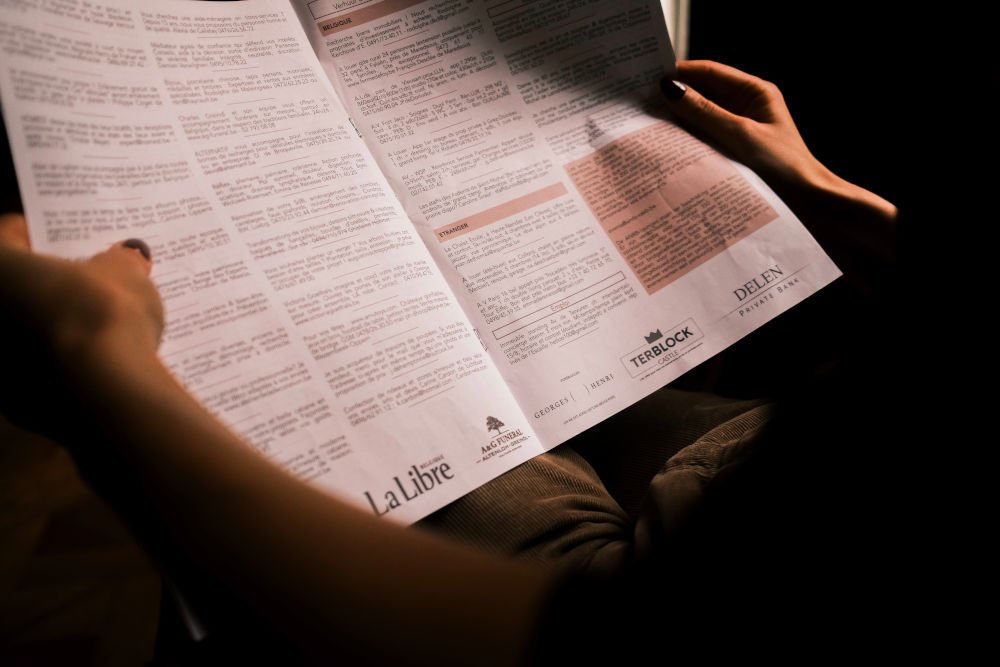
Nos annonces
Vous souhaitez proposer quelque chose à la vente ? Vous cherchez la location ou la maison de vos rêves ? Vous avez besoin d’un service particulier ?
Découvrez les petites annonces de nos membres et insérez vous-mêmes vos annonces.
Service réservé aux membres en ordre de cotisation
Privatiser la maison
Vous cherchez un espace pour organiser un événement, à caractère privé ou professionnel ? Une réunion, un séminaire, une conférence, un anniversaire, … ?
Le grand hall
Le grand hall est au centre de toute l’action. Il est orné d’une belle cheminée Renaissance, de tapisseries d’Aubusson et de lustres Louis XV imitant ceux de la bibliothèque Mazarine. Un très bel escalier d’honneur permet de monter à l’étage. C’est dans ce lieu magique que les moments les plus marquants de l'association ont pris naissance, créant des moments inoubliables pour certains de nos membres.
Le salon des jeunes
Le salon des JNB est une salle polyvalente. Cet espace cosy et festif est mis à disposition pour vos fêtes ou vos moments « lounge ».
Les salles de réunion
En tant que membre, vous pouvez privatiser nos salles de réunion, et même l'ensemble du bâtiment pour des célébrations plus importantes. Caroline Siraut et son équipe vous aidera à transformer les moindres détails en une expérience vraiment inoubliable.
La salle à manger
Attenant au grand hall principal, la salle à manger est un bel espace de près de 70 m². Les lambris aux murs lui donnent un caractère unique. Une seconde porte très discrète permet l’accès au traiteur de pouvoir servir l’ensemble des invités sans gêner la circulation de vos convives.
Le salon chinois
Le salon Louis XV aux panneaux de style chinois est situé au rez-de-chaussée et donne sur la terrasse de la maison. Il est agrémenté d’un parquet incrusté d’acajou.
Le salon bibliothèque
Le salon bibliothèque, situé à gauche de l'entrée, est un espace intime et raffiné. La pièce est ornée de boiseries et d’étagères de livres, invitant à la détente ou à la conversation. Une seconde porte, discrète, permet de rejoindre le grand hall, renforçant la fluidité et la circulation au rez-de-chaussée.Le salon bibliothèque se prête parfaitement à des dîners en petit comité, où l'on peut partager un moment convivial dans une ambiance feutrée et accueillante.
Soutenir l'anrb
Découvrez comment soutenir en toute confiance ceux qui en ont vraiment besoin.
Vous pouvez réellement faire la différence en soutenant SOLIDARITAS.
Votre don est précieux et nous vous en remercions.
Faire un don
