Découvrez l’Association
de la Noblesse du
Royaume de Belgique
ANRB - VAKB
À la une
Charles d’Orjo, au service du rayonnement de l’Abbaye de Maredsous
Charles d’Orjo de Marchovelette est le directeur général de l’ASBL Abbaye de Maredsous et le premier CEO laïc de son histoire. Ancien cadre dirigeant chez Unilever, il a passé douze ans à l’international avant de revenir en Belgique pour prendre en main l’une des institutions spirituelles, patrimoniales et touristiques les plus emblématiques du pays. Entre respect des valeurs bénédictines et impératifs économiques, il orchestre aujourd’hui une transformation en profondeur.Philippe de Potesta : Pourquoi après une carrière internationale, avez-vous choisi de gérer l’abbaye où vous avez été élève ?Charles d’Orjo :Après douze années passées chez Unilever, entre la Suisse, la Suède et les Pays-Bas, j’ai souhaité rentrer en Belgique pour des raisons personnelles, mais aussi pour donner davantage de sens à mon parcours professionnel. Je cherchais un nouveau job dans une organisation à taille humaine, centrée sur la Belgique et porteuse de valeurs et d’impact.L’Abbaye de Maredsous s’est imposée assez naturellement. C’est avant tout un lieu spirituel majeur, porté par une communauté d’une vingtaine de moines bénédictins, avec une histoire, une âme et une mission qui lui donnent une richesse tout à fait particulière. J’y ai été élève et j’ai toujours gardé un attachement très fort à ce lieu, à son esprit et à ce qu’il représente.Mais au-delà de cette dimension personnelle et spirituelle, l’Abbaye de Maredsous est aussi une marque extrêmement forte en Belgique, connue à travers ses fromages, ses bières et ses spiritueux. C’est également un site qui accueille plus de 650.000 visiteurs par an et qui emploie jusqu’à 200 personnes en haute saison. Avec nos fournisseurs et partenaires, nous générons aussi beaucoup d’emplois indirects dans la région.On est donc à la croisée de l’économie locale, du patrimoine et du spirituel, et cette combinaison est assez unique. C’est une position où l’on peut réellement avoir un impact économique, social, culturel et patrimonial, tout en restant fidèle aux valeurs et à l’âme du lieu.Philippe de Potesta : En quoi votre expérience passée en entreprise vous aide-t-elle au quotidien dans la gestion de l’abbaye ?Charles d’Orjo :Mon parcours m’aide surtout sur le plan de la gestion. Chez Unilever, j’ai travaillé dans différents métiers – le marketing, les ventes, puis la supply chain – avant de devenir directeur général pour la division Home Care dans les pays Nordiques. C’est là que j’ai vraiment appris ce que signifie piloter une organisation dans son ensemble : définir une vision, construire une feuille de route, fixer des priorités, piloter la gestion financière, fédérer les équipes et s’entourer des bonnes compétences.À Maredsous, même si le cadre est très particulier et différent, on retrouve en réalité tous les défis d’une PME traditionnelle : gouvernance, ressources humaines, gestion budgétaire, coordination de nombreuses activités très différentes. Nous gérons un centre d’accueil, des restaurants, une microbrasserie, des visites guidées, une boulangerie, une hôtellerie, une fromagerie, une distillerie, un atelier de céramique, un collège… C’est un ensemble assez complexe à orchestrer. Mon expérience me permet d’apporter une structure, de professionnaliser certains processus et de moderniser la gouvernance, tout en veillant à respecter profondément l’identité et les valeurs bénédictines du lieu.Philippe de Potesta : Quels sont actuellement les défis à relever pour l’abbaye et son site ?Charles d’Orjo :Le premier grand défi est évidemment la préservation du patrimoine. Le site est immense, magnifique, mais aussi extrêmement coûteux à entretenir. Nous parlons de plus de 1,6 million d’euros de frais d’entretien par an, auxquels s’ajoutent environ 300.000 euros de coûts énergétiques. C’est une charge structurelle très lourde.Le deuxième défi est l’équilibre économique. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’abbaye de Maredsous n’est pas riche. Nos activités nous permettent tout juste d’atteindre l’équilibre. Or, notre mission n’est pas de faire du profit, mais de faire rayonner le projet spirituel et culturel de Maredsous, d’accueillir le public, de soutenir la vie monastique et de préserver le patrimoine. Pour y parvenir durablement, nous devons renforcer notre efficacité opérationnelle et réfléchir à de nouveaux axes de développement.Il y a enfin un défi humain et organisationnel : faire travailler ensemble des moines et des laïcs, moderniser la gouvernance, gérer une forte saisonnalité et maintenir un très haut niveau d’accueil. Tout cela doit se faire sans jamais perdre de vue nos valeurs fondamentales, comme l’accueil et le tourisme social et familial.Philippe de Potesta : La remarquable basilique de Maredsous a fait l’objet de différents articles de presse ces derniers temps. Pouvez-vous m’en expliquer les raisons ?Charles d’Orjo :La basilique Saint-Benoît n’avait jamais eu de rénovation majeure depuis sa construction à la fin du XIXe siècle. Le nouveau Père Abbé a donc lancé un projet majeur baptisé « Basilique 2030 », qui prévoit une restauration en profondeur des toitures, des façades et des fenêtres. Le budget dépasse les 2,5 millions d’euros.La difficulté est que la basilique n’est pas classée, ce qui signifie qu’il n’y a, en principe, pas ou peu de subsides publics. Nous avons donc dû innover pour financer ce chantier. Nous avons noué un partenariat avec la Fondation Roi Baudouin pour organiser une levée de fonds, et nous avons aussi lancé une nouvelle bière, la Maredsous « Basilique », en collaboration avec Duvel Moortgat. L’intégralité des bénéfices de cette gamme est reversée au projet de rénovation. D’autres initiatives culturelles et événementielles complètent cet effort.Ce projet est fondamental. Il ne s’agit pas seulement de restaurer un bâtiment, mais de préserver le cœur de l’abbaye et un symbole majeur du patrimoine spirituel, culturel et architectural de la Belgique pour les générations futures.En souhaitant bonne chance à Charles d’Orjo de Marchovelette pour la suite de sa mission, je le remercie chaleureusement pour sa disponibilité et cet échange passionnant.Philippe de Potesta
Actualités
Boxe anglaise et blouse blanche : une battante sur tous les fronts
Aurore d’Udekem d’Acoz à 23 ans se donne sans compter entre ses études en soins infirmiers, la pratique de la boxe anglaise et son implication en tant que bénévole principalement pour deux associations bien utiles : Vacances pour Tous et Sawa.Philippe de Potesta : Qu’est-ce qui vous a guidée dans votre choix du métier d’infirmière ?Aurore d’Udekem d’Acoz : Donner du sens dans ce que je vis et dans ce que j’entreprends a toujours revêtu beaucoup d’importance pour moi. Je me suis longuement demandé ce qui me plaisait tant dans ce métier d’infirmière jusqu’au jour où je suis tombée sur cette citation de Mère Teresa reflétant exactement le fond de ma pensée : « La meilleure façon d’être transformé par l’amour, c’est de donner cet amour dont nous avons tant besoin ». Qui de nous n’a jamais ressenti de joie après avoir rendu un service ou aidé quelqu’un ? J’aime me dire qu’à mon échelle et même si ce n’est pas très significatif, j’aurai contribué à rendre notre monde meilleur et un peu plus heureux.Au-delà de cette dimension de service qui m’importe beaucoup, il faut savoir que je suis très reconnaissante envers chacun de mes patients. Ils m’enrichissent par leurs parcours de vie tous plus variés les uns que les autres, leur résilience et leur courage. Il n’y a pas un jour où je ne suis sortie de l’hôpital avec un précieux enseignement. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours considéré que toute personne, même la plus démunie, a quelque chose à m’apprendre. Je ne compte plus le nombre de fois où cela m’a été démontré.Philippe de Potesta : Qu’est-ce que vous apporte la pratique de la boxe anglaise dans votre quotidien ?Aurore d’Udekem d’Acoz : Plus qu’un simple sport de contact, la boxe anglaise a été une révélation pour moi qui apprécie beaucoup le challenge. Face à un adversaire devant lequel il faut parvenir à s’en sortir, la boxe m’a appris à rester maître de mes émotions en situation de stress tant sur le ring que dans mon quotidien. Mon coach Noa Goovaerts du Fight Off nous a toujours poussé à nous dépasser tout en persévérant dans l’épreuve. Il a su transmettre avec passion ces belles valeurs issues du noble art : l’humilité, la constance, le respect de son adversaire et la discipline.On pourrait penser que la boxe consiste simplement en un échange de coups. En réalité, il s’agit d’un véritable jeu d’échecs où l’observation et la stratégie priment pour faire basculer le combat en notre faveur. Cela passe par la maîtrise de l’espace afin d’amener l’adversaire là où on le souhaite sur le ring, par la lecture du jeu de l’autre pour anticiper ses déplacements et ses attaques, mais aussi par la mise en place de feintes et de pièges tactiques destinés à provoquer l’erreur chez l’autre et à prendre l’avantage.Philippe de Potesta : Qu’est-ce qui vous a touchée ou convaincue de choisir de faire du volontariat pour les associations Sawa et Vacances pour Tous ?Aurore d’Udekem d’Acoz : J’ai été très touchée par ces volontaires si courageux qui œuvrent dans l’ombre au profit des plus démunis. Ils mériteraient tellement d’être mis en lumière ! En débutant à Sawa, j’ai sans doute reçu l’une des plus belles leçons de ma vie : ne pas s’attendre à recevoir une quelconque reconnaissance de la part des gens à qui l’on vient en aide. Cela m’a permis de retrouver le sens profond de ce que je fais : la gratuité et la volonté de faire du bien.J’ai également été très touchée par le projet de ces deux associations. D’une part Sawa, fondée par le frère Patrick Gillard, vise à lutter contre la traite des êtres humains et vient en aide aux femmes prostituées notamment en allant à leur rencontre sur leur lieu de travail ou en leur fournissant un hébergement provisoire. J’ai rencontré le frère Patrick en 2014. Il était venu témoigner dans mon école secondaire, Saint-Boniface, de son travail d’aumônier de prison. Quelques années plus tard, j’ai été surprise de le revoir à Louvain-la-Neuve où il nous parlait cette fois du secteur de la prostitution. Très vite, nous avons été amenés à collaborer dans de nombreux projets. Ce désir de servir que je portais dans le cœur s’est alors transformé en opportunité.D’autre part, Vacances pour Tous, présidée par Benoît d’Hollander, accompagne en week-end et en vacances des enfants placés en institutions par le juge ou issus de famille en grande précarité.Cela faisait plusieurs années que j’entendais parler de VPT. Cette organisation me semblait très sympa. La rencontre de ces jeunes vivant des situations parfois très dures m’a donné envie de rejoindre le projet. Malgré leurs blessures et leurs difficultés émotionnelles, ils ont avant tout un immense besoin d’amour, et il est magnifique de voir que nous parvenons à créer ensemble des moments de joie et de lumière.Un tout grand merci à Aurore d’Udekem d’Acoz de nous avoir partagé son parcours si riche entre générosité et boxe, qui est une véritable source d’inspiration !Philippe de Potesta
Charles d’Orjo, au service du rayonnement de l’Abbaye de Maredsous
Charles d’Orjo de Marchovelette est le directeur général de l’ASBL Abbaye de Maredsous et le premier CEO laïc de son histoire. Ancien cadre dirigeant chez Unilever, il a passé douze ans à l’international avant de revenir en Belgique pour prendre en main l’une des institutions spirituelles, patrimoniales et touristiques les plus emblématiques du pays. Entre respect des valeurs bénédictines et impératifs économiques, il orchestre aujourd’hui une transformation en profondeur.Philippe de Potesta : Pourquoi après une carrière internationale, avez-vous choisi de gérer l’abbaye où vous avez été élève ?Charles d’Orjo :Après douze années passées chez Unilever, entre la Suisse, la Suède et les Pays-Bas, j’ai souhaité rentrer en Belgique pour des raisons personnelles, mais aussi pour donner davantage de sens à mon parcours professionnel. Je cherchais un nouveau job dans une organisation à taille humaine, centrée sur la Belgique et porteuse de valeurs et d’impact.L’Abbaye de Maredsous s’est imposée assez naturellement. C’est avant tout un lieu spirituel majeur, porté par une communauté d’une vingtaine de moines bénédictins, avec une histoire, une âme et une mission qui lui donnent une richesse tout à fait particulière. J’y ai été élève et j’ai toujours gardé un attachement très fort à ce lieu, à son esprit et à ce qu’il représente.Mais au-delà de cette dimension personnelle et spirituelle, l’Abbaye de Maredsous est aussi une marque extrêmement forte en Belgique, connue à travers ses fromages, ses bières et ses spiritueux. C’est également un site qui accueille plus de 650.000 visiteurs par an et qui emploie jusqu’à 200 personnes en haute saison. Avec nos fournisseurs et partenaires, nous générons aussi beaucoup d’emplois indirects dans la région.On est donc à la croisée de l’économie locale, du patrimoine et du spirituel, et cette combinaison est assez unique. C’est une position où l’on peut réellement avoir un impact économique, social, culturel et patrimonial, tout en restant fidèle aux valeurs et à l’âme du lieu.Philippe de Potesta : En quoi votre expérience passée en entreprise vous aide-t-elle au quotidien dans la gestion de l’abbaye ?Charles d’Orjo :Mon parcours m’aide surtout sur le plan de la gestion. Chez Unilever, j’ai travaillé dans différents métiers – le marketing, les ventes, puis la supply chain – avant de devenir directeur général pour la division Home Care dans les pays Nordiques. C’est là que j’ai vraiment appris ce que signifie piloter une organisation dans son ensemble : définir une vision, construire une feuille de route, fixer des priorités, piloter la gestion financière, fédérer les équipes et s’entourer des bonnes compétences.À Maredsous, même si le cadre est très particulier et différent, on retrouve en réalité tous les défis d’une PME traditionnelle : gouvernance, ressources humaines, gestion budgétaire, coordination de nombreuses activités très différentes. Nous gérons un centre d’accueil, des restaurants, une microbrasserie, des visites guidées, une boulangerie, une hôtellerie, une fromagerie, une distillerie, un atelier de céramique, un collège… C’est un ensemble assez complexe à orchestrer. Mon expérience me permet d’apporter une structure, de professionnaliser certains processus et de moderniser la gouvernance, tout en veillant à respecter profondément l’identité et les valeurs bénédictines du lieu.Philippe de Potesta : Quels sont actuellement les défis à relever pour l’abbaye et son site ?Charles d’Orjo :Le premier grand défi est évidemment la préservation du patrimoine. Le site est immense, magnifique, mais aussi extrêmement coûteux à entretenir. Nous parlons de plus de 1,6 million d’euros de frais d’entretien par an, auxquels s’ajoutent environ 300.000 euros de coûts énergétiques. C’est une charge structurelle très lourde.Le deuxième défi est l’équilibre économique. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’abbaye de Maredsous n’est pas riche. Nos activités nous permettent tout juste d’atteindre l’équilibre. Or, notre mission n’est pas de faire du profit, mais de faire rayonner le projet spirituel et culturel de Maredsous, d’accueillir le public, de soutenir la vie monastique et de préserver le patrimoine. Pour y parvenir durablement, nous devons renforcer notre efficacité opérationnelle et réfléchir à de nouveaux axes de développement.Il y a enfin un défi humain et organisationnel : faire travailler ensemble des moines et des laïcs, moderniser la gouvernance, gérer une forte saisonnalité et maintenir un très haut niveau d’accueil. Tout cela doit se faire sans jamais perdre de vue nos valeurs fondamentales, comme l’accueil et le tourisme social et familial.Philippe de Potesta : La remarquable basilique de Maredsous a fait l’objet de différents articles de presse ces derniers temps. Pouvez-vous m’en expliquer les raisons ?Charles d’Orjo :La basilique Saint-Benoît n’avait jamais eu de rénovation majeure depuis sa construction à la fin du XIXe siècle. Le nouveau Père Abbé a donc lancé un projet majeur baptisé « Basilique 2030 », qui prévoit une restauration en profondeur des toitures, des façades et des fenêtres. Le budget dépasse les 2,5 millions d’euros.La difficulté est que la basilique n’est pas classée, ce qui signifie qu’il n’y a, en principe, pas ou peu de subsides publics. Nous avons donc dû innover pour financer ce chantier. Nous avons noué un partenariat avec la Fondation Roi Baudouin pour organiser une levée de fonds, et nous avons aussi lancé une nouvelle bière, la Maredsous « Basilique », en collaboration avec Duvel Moortgat. L’intégralité des bénéfices de cette gamme est reversée au projet de rénovation. D’autres initiatives culturelles et événementielles complètent cet effort.Ce projet est fondamental. Il ne s’agit pas seulement de restaurer un bâtiment, mais de préserver le cœur de l’abbaye et un symbole majeur du patrimoine spirituel, culturel et architectural de la Belgique pour les générations futures.En souhaitant bonne chance à Charles d’Orjo de Marchovelette pour la suite de sa mission, je le remercie chaleureusement pour sa disponibilité et cet échange passionnant.Philippe de Potesta
Jean Rubay : guérir un enfant, c'est lui offrir un avenir
Chaîne de l’Espoir, voilà bien une expression qui fait jaillir des étoiles dans les yeux ! Et ce n’est pas un mirage. Nous en voulons pour preuve les réponses que le baron Jean Rubay, professeur émérite de chirurgie cardiaque et président fondateur de la Chaîne de l’Espoir nous a données. Professeur, vos spécialisations sont la chirurgie cardiaque pédiatrique ainsi que la chirurgie cardiovasculaire et thoracique que vous avez pratiquées en France Angleterre Afrique du Sud et Australie. Comment s’est enclenché ce chemin ?Il y a eu en plus de la transmission génétique et intellectuelle paternelle, la conviction de l’aide au prochain, la passion pour la création et la reconstruction qui trouve son expression dans la chirurgie cardiaque qui est une chirurgie de réparation d’une malformation présente dès la naissance.Comment est née la Chaîne de l’Espoir Belgique- Keten van Hoop België?En raison de la facilité d’accès aux soins les plus qualifiés dans notre pays ainsi que leur quasi-gratuité et imprégné de l’altruisme lié à notre profession, il nous est apparu évident qu’il fallait offrir cette même qualité sanitaire aux pays qui en disposaient le moins.Face à ce constat, les cardiologues pédiatres André Vliers et Thierry Sluysmans se sont joint à moi, chirurgien cardiaque pour fonder en 1997 l’association, copie belge de celle de France bien que strictement indépendante. Reconnue ONG en 2004, elle a grandi sous l’impulsion de sa directrice Anita Clément de Cléty. Son Conseil d’Administration rassemble des professionnels issus de divers horizons, assurant ainsi la stabilité et la vision de notre action.Notre slogan est : une malformation, une opération, une guérison, une formation. Après l’Amérique latine - Bolivie, Vénézuéla et Nicaragua -, c’est vers le continent africain que ce sont portés nos efforts, en particulier la RDCongo et le Bénin.Vous avez des projets dans différents pays ; comment opérez-vous des choix et comment les réalisez-vous ?Ce sont les médecins locaux, souvent formés en Belgique, qui font appel à notre association. Nous intervenons dans les domaines cardiaques, orthopédiques, urologiques : en fait, le choix se porte sur toute malformation infantile qui peut être guérie par un geste chirurgical. Pour qu’un projet soit réalisable, des conditions minimales doivent être réunies, notamment des infrastructures hospitalières suffisamment adaptées. La Chaîne de l’Espoir Belgique apporte alors son expertise médicale, un appui financier ciblé et un accompagnement pour renforcer les services de pédiatrie et de chirurgie.Notre approche vise également la pérennité : nous collaborons avec les autorités locales afin de les sensibiliser aux besoins spécifiques de la santé infantile, et les incitons à investir pour combler les manques souvent dramatiques qui se situent à différents niveaux : enseignement universitaire, formation, soins et gestion.Vous opérez des enfants en Belgique. Comment se passe leur prise en charge depuis leur pays jusqu’à Bruxelles ?Seule une minorité d’enfants est transférée en Belgique. Cela se produit lorsque le délai entre deux missions chirurgicales est trop long pour garantir leur prise en charge locale ou si l’association n’intervient pas dans le pays. Nous recevons des demandes via des médecins locaux, les dossiers sont analysés par un comité médical belge composé de spécialistes de la pathologie de l’enfant. Si les critères médicaux sont réunis et que le financement est assuré, l’enfant est alors accueilli en Belgique. L’enfant vient sans ses parents et est accompagné durant les voyages par des bénévoles d’Aviation Sans Frontières. Il est accueilli dans des familles qui leur procurent toute l’attention et l’amour durant toute la durée de ce séjour traumatisant.Le contact est maintenu quotidiennement avec la famille biologique. Après 6 à 8 semaines, une fois l’intervention et le suivi terminés, l’enfant peut rentrer guéri auprès des siens.Formez-vous aussi des médecins ou des équipes médicales dans ces différents pays ?L’essentiel de notre activité se passe dans les pays précités. Le « primum movens » de notre association est la formation pour qu’ils puissent à terme plus ou moins lointain le faire par eux-mêmes. A cette fin nous avons mobilisé les quatre centres universitaires agréés belges qui pratiquent la chirurgie pédiatrique congénitale- UCL, KUL, UZ GENT et HUDERF - et cette collaboration en plus d’être enrichissante fait ma fierté.La chirurgie qu’elle soit cardiaque ou orthopédique sauve des vies au quotidien et la Chaîne de l’Espoir Belgique incarne remarquablement cette mission à l’échelle mondiale, tout imprégnée de la conviction que guérir un enfant c’est lui offrir un avenir ! Au terme de cet interview, il me semble que le mot « magnifique » peut être prononcé moultes fois et cela fait chaud au cœur : c’est le cas de le dire !www.chaine-espoir.bePlace Carnoy, 151200 Bruxelles Belgiqueinfo@chaine-espoir.be+32 2 764 20 60+32 478 60 50 98Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour cette interview.
Edouardo della Faille : Le talent ne connaît pas la différence
Portrait : Edouardo della Faille de Leverghem, 38 ans, est un artiste sensible et créatif. Observateur attentif du monde, il aime s’exprimer par les mots autant que par le corps. Danseur, circassien et comédien, il s’est produit à de nombreuses reprises sur scène. Il joue actuellement dans Justices, un spectacle inspiré de La Divine Comédie de Dante.Comment le théâtre est-il entré dans votre vie ?Le théâtre est d’abord entré dans ma vie à l’école, puis à travers ma participation à deux spectacles de L’Enfant des Étoiles. Les rencontres avec Jacqueline Beghin (L’art d’être différent), Frédérique Joye (Mouvements sans frontières) et Joëlle Shabanov du Créahmbxl ont été déterminantes. Elles m’ont permis de découvrir le besoin d’exprimer mes émotions, le plaisir de raconter des histoires et celui de rencontrer les autres. Très vite, la scène est devenue pour moi un véritable espace de liberté.Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier d’acteur ?Ce que j’aime par-dessus tout, c’est incarner des personnages différents. Chaque rôle est une nouvelle aventure humaine. Le contact avec le public est une grande source d’émotion. J’aime aussi voyager avec la troupe et partager de bons moments ensemble.Qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans la pièce Justices, dans laquelle vous jouez actuellement ?Ce qui me touche le plus, c’est le message de justice et d’humanité porté par le spectacle. Il invite le public à réfléchir à la responsabilité, à la vérité et au regard des autres. J’y joue avec beaucoup d’engagement et de sincérité.Où pourrez-nous vous voir prochainement ? Et quels sont vos projets à venir ?Je jouerai début janvier à Marseille, puis les 4 et 5 février au Théâtre Le Manège à Mons, et du 7 au 11 avril au Théâtre National à Bruxelles. D’autres dates pour 2026 et 2027 sont en cours de confirmation. Je participerai également à un projet européen autour du théâtre inclusif à Varsovie en mars, avec Clément Papachristou, metteur en scène de Justices. Par ailleurs, un nouveau spectacle de danse, Mon Amour, est actuellement en création avec Joëlle Shabanov, chorégraphe au Créahmbxl.📍 Prochaines dates de JusticesDébut janvier à Marseille4 et 5 février au Théâtre Le Manège – MonsDu 7 au 11 avril au Théâtre National de BruxellesNous remercions monsieur Philippe de Potesta pour cette interview.
Patricia de Cooman : la solidarité en action, soir après soir
Patricia de Cooman fait partie de ces personnes qui transforment la solidarité en action concrète. Bénévole de longue date, elle s’engage au sein de l’ASBL Opération Thermos, qui va à la rencontre des personnes en grande précarité à Bruxelles avec des repas chauds, une écoute et une présence. Dans cet échange, elle évoque l’engagement des bénévoles, la réalité du terrain et les besoins de l’association pour poursuivre sa mission. “En une minute, peux-tu me dire c’est quoi l’Opération Thermos, et pourquoi elle existe ?”‘Opération Thermos’ est née en 1987, à l’initiative de scouts sensibilisés à la précarité des personnes vivant dans la rue. Devenue ASBL, elle distribue chaque soir, du 1er novembre au 30 avril, des repas chauds et des boissons. La distribution a lieu au métro Botanique à 20h : soupe, plat chaud, dessert, pain, eau, café ou chocolat chaud.Pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans ce projet et qu’est-ce que cela t’apporte ?Il y a 23 ans, nous avons entendu un appel à la paroisse : il manquait des bénévoles. Nous voulions un projet humanitaire familial, près de chez nous, et nos deux fils (12 et 10 ans à l’époque) ont tout de suite été partants. Aujourd’hui, ils ont grandi, sont devenus papas et continuent à venir distribuer avec nous : la relève est assurée. On reçoit énormément en retour, et nous avons même créé des liens avec certains bénéficiaires.À qui vous vous adressez ? Qu’est-ce qui vous distingue dans l’aide aux personnes en grande précarité ?Nos bénéficiaires sont de plus en plus nombreux : nous sommes passés d’environ 80–100 repas à une distribution que nous devons limiter à 200, faute de moyens financiers et logistiques. Le repas est totalement gratuit.Concrètement, comment se déroule une soirée type : de la préparation à la distribution ?Dès 16h, une dizaine de bénévoles cuisinent sous la supervision d’un encadrant. Les repas sont acheminés au métro Botanique en bus STIB, partenaire de l’association. À partir de 19h15, d’autres bénévoles accueillent les bénéficiaires ; le repas est remis en sac “take away”.Si je comprends bien, une saison s’étend de novembre à avril : combien d’équipes/volontaires sont mobilisés sur une saison ?Chaque soir, une équipe se relaie pour assurer la distribution des 200 repas : parfois des entreprises (team building), mais aussi des groupes de jeunes ou d’adultes, sensibilisés au sans-abrisme. Certaines équipes reviennent plusieurs fois, d’autres une seule. .Aujourd’hui, de quoi avez-vous le plus besoin pour continuer, et comment aider concrètement ?Nous avons surtout besoin d’aide humaine et financière : il manque des bénévoles en station, et encore plus en cuisine. Les dons de vivres/repas sont appréciés, mais les dons financiers le sont particulièrement (déduction fiscale dansles règles de la loi). Bonnets, écharpes, gants et chaussettes sont utiles lors des grands froids (pas de vêtements).Le planning de cet hiver n’est pas encore complet, n’hésitez pas à vous inscrire ici planning@operationthermos.be Patricia de Cooman reste à votre disposition pour toutes questions ou suggestions : decoomanthibault@hotmail.com
Événements
Bowling
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’afterwork Bowling organisé par le Cercle Franklin de l’ANRB. Le Cercle Franklin organise des activités festives, sportives, culturelles, … destinées aux membres de la noblesse de 35 à 55 ans.
Impro du lundi @ ANRB
Envie de lâcher prise, de rire et de stimuler votre créativité ? Rejoignez notre tout nouveau cycle de séances d’improvisation, un moment à la fois ludique, dynamique et convivial, pensé pour se faire plaisir et oser autrement. Paiement : 40 € pour les 4 séancesDate et Lieu : Les lundis de 14h à 16h à l’ANRB - Avenue Franklin Roosevelt 251, 1050 BruxellesGroupe limité à 16 participants.
Midis Culturels : « L’intelligence artificielle au secours de la médecine » de Monsieur Benoît Macq
Conférence « L’intelligence artificielle au secours de la médecine » de Monsieur Benoît Macq, professeur à l’École Polytechnique (UCL).
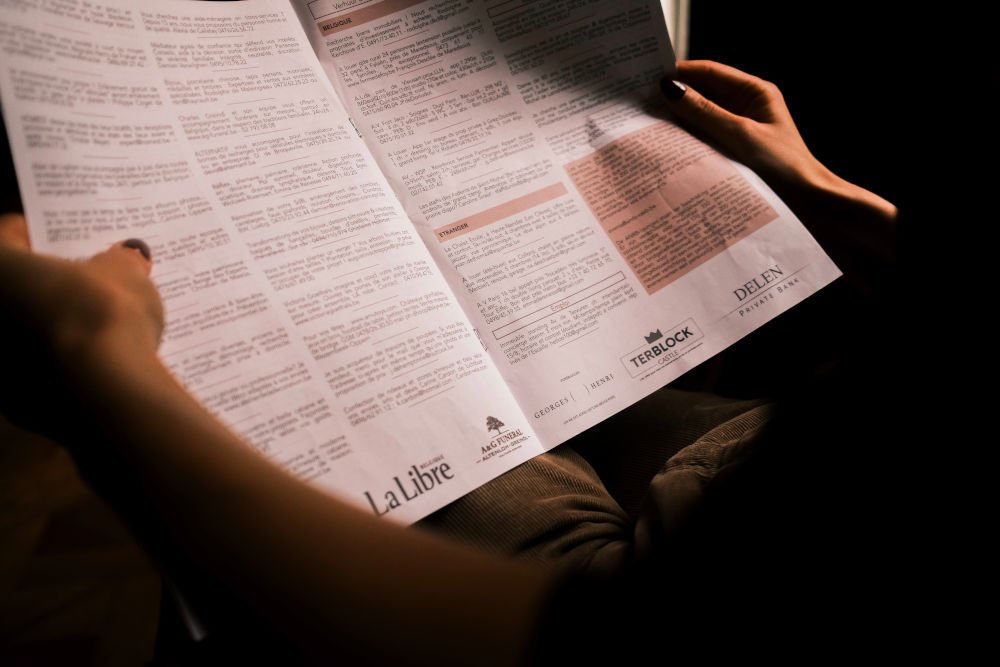
Nos annonces
Vous souhaitez proposer quelque chose à la vente ? Vous cherchez la location ou la maison de vos rêves ? Vous avez besoin d’un service particulier ?
Découvrez les petites annonces de nos membres et insérez vous-mêmes vos annonces.
Service réservé aux membres en ordre de cotisation
Privatiser la maison
Vous cherchez un espace pour organiser un événement, à caractère privé ou professionnel ? Une réunion, un séminaire, une conférence, un anniversaire, … ?
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Bozar people
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Choregos Solution
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Organon
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Organon A+projects
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Document texte not found (C:\Users\ANRB00\Desktop\Organon PROD\websites\Textes\0)
Soutenir l'anrb
Découvrez comment soutenir en toute confiance ceux qui en ont vraiment besoin.
Vous pouvez réellement faire la différence en soutenant SOLIDARITAS.
Votre don est précieux et nous vous en remercions.
Faire un don
